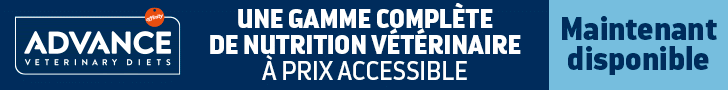La médecine narrative permet de lire dans l'animal qui souffre
Mercredi 19 Juin 2024 Animaux de compagnie 51051La médecine narrative appartient au florilège des humanités médicales dont la principale qualité est d'apporter à la médecine scientifique une approche interdisciplinaire vertueuse dans la pédagogie médicale et l'exercice clinique.
© D.R.
Thierry POITTE
CAPdouleur
DIU Douleur
CES Traumatologie et chirurgie ostéo-articulaire
Clinique vétérinaire Ile de Ré
(17630 La Flotte en Ré)
Douleur
La médecine narrative appartient au florilège des humanités médicales dont la principale qualité est d'apporter à la médecine scientifique une approche interdisciplinaire vertueuse dans la pédagogie médicale et l'exercice clinique. Elle est particulièrement adaptée à la prise en charge des douleurs chroniques. Recevoir les paroles du propriétaire permet en effet de mieux lui répondre et procure un bénéfice clinique.
Selon l'ouvrage fondateur de Rita Charon (2006), la médecine narrative (MN) est une médecine exercée avec une compétence narrative permettant de reconnaître (au sens d'accueillir), d'absorber (au sens d'accompagner), d'interpréter (au sens d'éclairer) les histoires de maladie et d'être transporté (ému) par elles*.
La MN est particulièrement adaptée à la prise en charge des douleurs chroniques car celles-ci ne se résument pas à des évènements sensoriels isolés et reproductibles quels que soient les individus : en effet, la douleur s'élabore au sein d'un système nerveux périphérique et central agressé, configuré par un héritage génétique, imprégné par son vécu et façonné par un contexte émotionnel et cognitif influent.
Face à l'animal qui souffre, le praticien ne doit pas oublier qu'il est aussi « de compagnie » et qu'ainsi, le soin ne peut se comprendre sans regarder, écouter et comprendre ce propriétaire qui vit avec un être vivant qui souffre (Guy Simonnet).
La subjectivité est consubstantielle de la douleur, ce qui explique que la douleur ne se mesure pas avec objectivité mais qu'elle s'évalue avec... tact et mesure grâce au regard du propriétaire, toujours particulier, parfois tendancieux et tellement influencé par la contagion émotionnelle qui peut entraîner ce couple Homme-animal dans la vulnérabilité.
Ecouter le propriétaire
Le propriétaire est invité à décrire (ou mieux à écrire) ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il pense et ce qu'il craint pour son animal (Je ne veux pas qu'il souffre).
Son langage est à la fois verbal (voix, diction, vitesse d'élocution, champs lexicaux, tournures de phrase, métaphores, rhétorique, non-dits...), non verbal (postures, gestuel, regard, proxémie...) et para-verbal (intonation émotionnelle, rythme, gestion des blancs...).
Le praticien est lui aussi invité à écouter ce propriétaire dont la parole n'est pas égotique mais dans l'échange avec un professionnel de santé qui reçoit la narration avec respect et compétence.
L'écoute du praticien est passive, accompagnée d'un langage corporel attentif (actio en rhétorique), suivi d'une écoute active bienveillante avec peu de questions fermées aux réponses binaires (est-ce que votre chien a mal ?) et beaucoup d'interrogations ouvertes optimisant la description des souffrances vécues (décrivez-moi la douleur de votre chien, les conditions de survenue et d'apaisement ?).
Une méthodologie en trois mouvements
Le praticien est ainsi entraîné dans une série de trois mouvements, chers à la méthodologie de la MN développée par Rita Charon :
1 L'attention qui est l'attitude du soignant à se concentrer sur le récit et à en exprimer sa compréhension (cf. supra).
2 La représentation qui consiste à structurer et formaliser la richesse des informations recueillies, en vérifier les liens avec la douleur chronique et les conserver sur un support documentaire ou digital.
La grille d'évaluation CSOM (Client Specific Outcomes Measures) remplit cet objectif en sélectionnant les trois critères de douleur les plus emblématiques au regard du propriétaire, parmi des signes de mobilité et de handicap fonctionnel, de qualité de la douleur (inflammatoire, neuropathique, nociplastique) et de perturbations émotionnelles à l'origine de changements comportementaux.
Le récit est très souvent remarquable par la précision des qualificatifs évocateurs de douleurs mécaniques (diminuant au repos, contemporaines de l'exercice), inflammatoires (nocturnes, diminuant à l'exercice, responsables de raideur matinale, qui réveillent mon animal), neuropathiques (spontanées, avec des accès de fulgurance comme s'il avait reçu une décharge électrique ou un coup de poignard, paresthésies de type fourmillements ou dysesthésies de type picotements, comme s'il avait une puce sous la peau), nociplastiques (vulnérabilité, hyperalgésie, allodynie, ne supportant plus qu'on le caresse).
Un premier ancrage relationnel
Au-delà d'un scoring d'intensité ou de fréquence gradé sur une échelle de 4, ces items précisés, qualifiés et sélectionnés attestent de la pertinence du modèle de l'animal qui souffre. La représentation valorise la subjectivité à la fois de l'expérience douloureuse du propriétaire mais aussi de sa sensibilité à traduire celle de son animal.
3 L'affiliation désigne la relation nouée entre un écrivain et son lecteur, entre un narrateur et l'écoutant, entre un propriétaire d'animal qui souffre et son équipe vétérinaire soignante : rendre visible l'invisible, la douleur silencieuse audible, la souffrance indicible racontable.
L'affiliation répond à la demande d'écoute du propriétaire et affiche l'empathie du praticien. L'empathie se définit par la capacité de partager et comprendre les émotions d'autrui (le propriétaire) dans la finalité de l'aider.
Finalement, la démarche d'empathie suit les étapes de la MN à travers les mêmes volets émotionnels (observer, prendre conscience, partager l'état émotionnel de quelqu'un), cognitifs (interpréter cet état émotionnel avec justesse) et motivationnels (réagir, aider et ainsi répondre au fardeau de l'aidant).
L'affiliation amarre un premier ancrage relationnel de confiance et de compréhension du fardeau (burden) physique, psychologique, émotionnel, social, financier et de la charge de travail (workload), double servitude subie par le propriétaire.
À travers le récit narratif, des profils différents se dessinent : propriétaires en détresse liée à leur animal, résilients dans l'acceptation, en détresse liée à d'autres facteurs, peu affectés.
Limiter les erreurs de communication
La compréhension de ces distinctions permet au clinicien de mieux répondre au client de manière appropriée en limitant les erreurs de communication et en partageant une éthique relationnelle de soins pour respecter la qualité de vie de l'animal souffrant et éviter tout acharnement thérapeutique.
Enfin l'affiliation est une source dynamique d'alliance thérapeutique dont le but ultime au-delà de l'observance est l'empowerment du propriétaire, c'est-à-dire son autonomisation, sa capacité à devenir un acteur décisionnaire de la prise en charge de son animal qui souffre.
L'évaluation des douleurs chroniques est insuffisamment pratiquée par les vétérinaires par manque de reconnaissance de son utilité et par l'aspect chronophage des grilles universitaires validées.
Pourquoi évaluer les douleurs chroniques : parce que ce sont des maladies définies comme telles par l'Organisation modiale de la santé dans la Classification internationale des maladies (CIM-11) et qu'elles relèvent ainsi d'un raisonnement clinique.
Quels sont les signes à évaluer : mobilité et handicap fonctionnel, qualité de la douleur, perturbations émotionnelles à l'origine de changements comportementaux.
Comment évaluer et avec quelle méthodologie :
- première étape de médecine narrative avec l'indispensable représentation (grilles CSOM par exemple),
- deuxième étape d'examen clinique,
- troisième étape de parcours de suivi pour tenir compte de la nature multimorphe de la douleur, se transformant tout au long de l'évolution défavorable de la maladie causale (dégénérative, inflammatoire ou proliférative) mais aussi de l'évolution souhaitée favorable du projet thérapeutique.
Un processus continu et partagé
Par conséquent, l'évaluation de la douleur doit être un processus continu et partagé entre le praticien et le propriétaire. La MN procure un bénéfice clinique fort à ces étapes évaluatives en développant la capacité d'attention au propriétaire, en s'imprégnant de la relation singulière qui l'unit à son animal de compagnie, en cultivant l'empathie envers lui, enfin en développant la prise de conscience et la dimension éthique des situations.
La MN appartient au florilège des humanités médicales dont la principale qualité est d'apporter à la médecine scientifique une approche interdisciplinaire particulièrement vertueuse dans la pédagogie médicale et l'exercice clinique. ■
Un prochain article présentera ce sujet.
* Rita Charon, Narrative Medicine : Honoring the Stories of Illness, Oxford, Oxford University Press, 2006 : Médecine narrative. Rendre hommage aux histoires de maladies, trad. sous la direction du Dr Anne Fourreau, coll. Sciences humaines, Aniche, Sipayat, 2015.