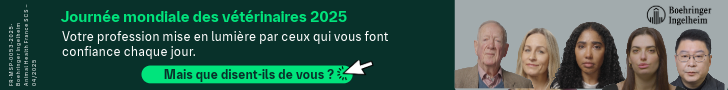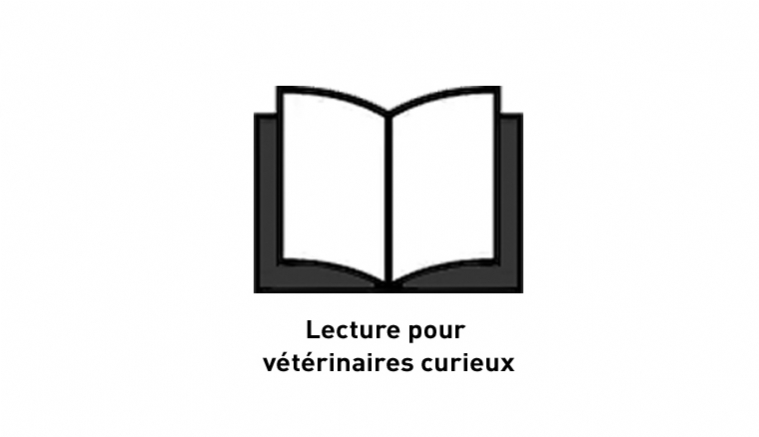Dans la tête d'un chien - Les dernières découvertes sur le cerveau animal
Samedi 27 Juin 2020 Lecture 41776Thierry JOURDAN, docteur vétérinaire
Gregory Berns est un psychologue professeur dans le département de Psychologie de l'université Emory aux Etats-Unis. Outre de nombreuses publications dans « Sciences » ou « Nature », il est un vulgarisateur hors pair dans des journaux comme le «New York Times».
En 1974, le philosophe Thomas Nagel publia un essai intitulé « Qu'est-ce que cela fait d'être une chauve-souris ? ». Thomas Nagel prétendait que les neurosciences ne pourraient jamais espérer rendre compte de l'expérience subjective de pensées ou de sentiments.
L'auteur, propriétaire régulier de chiens, se demandait donc régulièrement « qu'est-ce que ça fait d'être un chien ? » et projeta d'effectuer de l'imagerie fonctionnelle sur ces compagnons de vie. Après lourds entraînements dans un simulateur IRM d'une vingtaine de chiens dont les maîtres étaient volontaires, des expériences simples telles que associer des mouvements de main à des offres de friandises montrèrent que les structures qui s'activaient étaient équivalentes au cerveau humain (le noyau caudé). En quatre ans, les exercices devenaient plus complexes et tenaient compte des besoins et envies, des tempéraments aussi. Les biais étaient anticipés et la compétence des maîtres accrus. La maîtrise de soi ou la capacité à s'inhiber a été testée grâce au test Go-NoGo (test du Marshmallow de Walter Mischel chez les enfants) afin d'identifier les centres de contrôle des pulsions (sifflet du maître et
toucher une cible avec la truffe en temps voulu ou se retenir de le faire, afin d'obtenir une récompense). L'étape suivante était d'effectuer le même exercice dans un vrai IRM avec des groupes témoins. Comme chez les humains, une petite zone du lobe frontal est en jeu. Afin de discriminer auto-apprentissage et dressage, le test A-nonB basé sur la permanence de l'objet est appliqué à l'aide de trois seaux où l'objet de récompense est placé sous un seau à la vue du chien : la corrélation avec le test Go-NoGo était établie. Tous les exercices montraient qu'il n'y pas de différence de fonctionnement et de motivation entre un cerveau de chien et un cerveau humain.
A quoi peut donc servir un cerveau quand pour 2 % du poids total de l'organisme, il dépense 20 % de son énergie, sachant que lorsqu'il y a un système nerveux, il y a un système musculaire : les animaux ont des cerveaux pour agir face aux perceptions à un premier niveau, pour adapter leurs actions à leur environnement à un deuxième niveau, pour apprendre à un troisième niveau, pour simuler les actions possibles et leurs résultats futurs afin de prendre la meilleure décision possible en fonction de la situation à un quatrième niveau. Le poids du cerveau est approximativement proportionnel au poids du corps élevé à la puissance 2/3. Suivant les besoins du milieu, les aires olfactives, visuelles, auditives ou autres perceptions sont proportionnellement plus ou moins importantes suivant les espèces mais la nature fondamentale du cerveau ne change pas chez les mammifères et ce sont les connectivités entre les différentes parties du cerveau qui permettent de comprendre l'esprit et les sensations des animaux. Ce sont ces connexions qui déterminent le degré de conscience accessible au travers de la perception, des émotions, des mouvements, de la mémoire et des communications. Pour observer les connexions, on dispose d'une technique d'imagerie par tenseur de diffusion, basé sur les mouvements des molécules d'eau, qui n'aimant pas le gras donc la substance blanche, suivent les axones.
En 1987 une épidémie générant troubles digestifs et neurologiques eut lieu à Montréal chez des personnes qui avaient mangé des moules : ces moules contenaient une algue secrétant de l'acide domoïque résistant à la cuisson qui agit comme une décharge de glutamate et « brûle » des neurones dans les lobes temporaux médians.
En 1998, ce furent des otaries qui furent touchées à Monterey par le biais des mêmes algues contenues dans des anchois et sardines. Un centre s'occupant de soins et de recherche pour les mammifères marins s'y trouvait. Pour savoir si une otarie était touchée une IRM sous anesthésie était pratiquée afin de constater si, oui ou non, l'hippocampe était touché. De proche en proche, des tests pour otaries furent élaborés à base de labyrinthe et de nourriture afin d'établir des corrélations entre réussites au tests et taille de l'hippocampe. L'exposition chronique à l'acide domoïque induisait des lésions sur l'hippocampe et les lobes temporaux et des pertes d'orientation de plus en plus importantes jusqu'à des épilepsies.
La capacité des otaries à comprendre des langages manuels amena les équipes à explorer ces capacités : qui dit langage dit pensées et facultés de les exprimer. Les otaries sont capables de logique inductive, d'apprentissage par exclusion, elles sont capables de rythme.
Suivent de nombreuses réflexions sur l'éthique et la souffrance animale, des aventures avec les dauphins, d'autres connaissances sur les chiens, les diables de Tasmanie et les....... Thylacines. Mais, comment diable explorer des cerveaux d'animaux disparus, avoir ce qu'ils pensaient ? La technique d'Imagerie par tenseur de diffusion fonctionne à partir de cerveaux suffisamment bien conservés dans le formol. Les connexions nous disent beaucoup du fonctionnement d'un cerveau et l'on se prend à imaginer comment un thylacine se comportait dans son milieu.
Il s'agit d'un livre très vivant, simple de lecture et enthousiasmant comme les Nords-Américains ont le don de produire.